* De gauche à droite: Conférence de Yalta en 1945, 70 ans du régime communiste Chinois, Assemblée générale des Nations-Unis, et les 4 géants du Web.
La fin de la guerre froide, consécutive à l’effondrement de l’URSS en 1991 garantissait l’expansion mondiale du libéralisme et de la démocratie pour nombres d’experts. En 2021, le trentenaire de cette victoire laissera un goût amer pour les USA. Le monde unipolaire tant attendu ne dura qu’une brève décennie. Les gouvernements américains successifs n’ont pu et su capitaliser sur l’absence d’adversaire. Leur trop grande confiance en leur force biaisa leurs analyses. Les institutions nées après la Seconde Guerre Mondiale permirent de maintenir la stabilité, jusqu’à présent. Le siège de ces organisations se trouve aux USA(1), et elles font de cette nation le centre de gravité de l’ordre mondial. La venue de nouvelles puissances sur l’échiquier international à la recherche de leur intérêt national change la donne. La Realpolitik(2) est de nouveau à l’ordre du jour.

Le chef d’orchestre américain (1918-2003)
Le système des États tel qu’il a été conçu au cours de l’histoire européenne s’est globalisé(3). La superpuissance américaine tantôt croisé de la liberté, tantôt ermite, a façonné le système mondial contemporain. En 1918, la faiblesse économique et idéologique d’une Europe épuisée par la guerre donna une opportunité unique dans l’histoire des nations. Woodrow Wilson, le président des USA appela au respect de la liberté des peuples(4). Son influence sur le traité de Versailles favorisa l’émergence de nombreux États en Europe Centrale. La Première Guerre Mondiale permit de prendre l’ascendant moral sur un vieux continent exsangue. La Deuxième Guerre Mondiale apporta la touche finale en donnant le leadership international et économique à Washington. La force de l’Amérique fut telle – après guerre les USA représentait 60% de la production industrielle mondiale – qu’elle modela le monde tel qu’elle le voyait par le prisme de la liberté. Elle contint l’URSS pendant plus de soixante ans et sa chute amena à l’indépendance de quinze États.

Il s’en suivit une domination mondiale sans partage, avec la présence d’une menace se présentant sous une forme différente. Elle s’identifia moins à des États, qu’à des groupes armés(5). La guerre sous la forme conventionnelle telle que nous l’avons connu évolua en une guerre dite asymétrique, une guérilla moderne. Le gouvernement américain s’adapta à cette évolution et conserva cet équilibre entre morale et interventionnisme. Cette maîtrise globale s’étiola à partir de 2003 avec la seconde intervention des marines en Irak. A la faveur de cette guerre, la nation américaine perdit de sa crédibilité morale et militaire. Moralement, elle intervint sur des allégations mensongères et une partie de ses troupes se comportèrent en tyran(6). Militairement, elle acquit rapidement la victoire, mais ne vit pas la constitution d’une puissante insurrection. Ce mélange d’incompétence et d’immoralité facilita la naissance de l’État Islamique. Ce fut la première lézarde a l’édifice moral américain, que cette nation s’infligea seule. De nos jours, l’arrivée de nouvelles puissances met de nouveau les États-Unis face à leurs contradictions. Le système international bâti par et pour Washington ne laisse que peu de place à d’autres. Les institutions internationales – FMI, BIRD et ONU – ne reflètent pas les changements intervenus. Prenons l’exemple de la Chine, elle participe à l’économie mondiale à hauteur de 17.3% contre 15.8% pour les USA. Pourtant, elle ne possède que 6.09% de Quotes parts contre 16.52% pour les États-Unis au sein du FMI(7). Les relations entre anciennes et nouvelles puissances se crispent face aux manques de considérations et de conciliations, venant d’un pays se posant en champion du droit. Dans le fond l’Amérique acceptera-t-elle de partager la mission qu’elle s’est assignée – la concorde mondiale – ? Si la réponse est non, un monde avec des sphères d’influences régionales regroupées autour de puissances majeures ne semble pas être une chimère. La politique internationale de Donald Trump met le monde au service d’une Amérique seulement concernée par ses besoins. Les alliances de longues dates subissent les humeurs de Washington. La première puissance mondiale amorce une nouvelle phase isolationniste sous la présidence de Trump, après un siècle d’interventionnisme aux quatre coins du globe.
La Chine et l’Asie
Parmi les nouvelles nations aspirants à prendre la place qui leur est due, l’Empire du Milieu fait figure de champion. Depuis les années 2000 et la fulgurance de sa croissance économique, la Chine apparaît comme le nouveau challenger mondial, prête à disputer à Washington sa place de leader. L’édification de centres culturels, d’un Nobel et d’un “Hollywood” chinois manifeste les intentions de Pékin de diffuser sa culture mondialement. Cet ensemble familiarisera les populations étrangères à une insertion économique massive. La construction des “nouvelles routes de la soie”(8) ancrera définitivement une partie de l’économie des territoires des pays concernés par ce projet pharaonique, tout en sécurisant l’approvisionnement en denrées vitales. Zhongnanhai suit la logique confucéenne millénaire ; “la Chine se situe au sommet de la hiérarchie, juste sous le ciel. Sa sécurité dépend du contrôle qu’elle exerce sur les autres nations. La violence apparaît comme un dernier recours, il y a d’autres moyens de prendre le dessus.” L’ascension de la Chine sur le sommet international ne se fera pas sans heurt. Elle a les moyens de ses ambitions malgré des faiblesses internes qu’elle masque(9).

L’équilibre asiatique ne tient pas à une seule nation. D’autres pays peuvent agir en pivot, les États-unis et le Japon en tête. Un désengagement américain dépend moins d’un lâchage de Tokyo que d’un revirement de Washington. Les tensions en mer de Chine ne risquent pas d’aboutir à un accrochage sérieux et ce tant que les richesses espérées ne se confirment pas. Autre acteur majeur, l’ASEAN – Association des nations d’Asie du Sud-Est – maintient des relations cordiales avec Washington et Pékin. Elle ne peut risquer d’irriter ses deux plus grands partenaires(10) – politique et économique -. La péninsule Coréenne avec la Corée du Nord représente le premier point chaud de la zone. Pyongyang use de la menace atomique pour sauver son régime, plus que pour conquérir quoi que ce soit(11). La bombe nucléaire donne la possibilité à cette nation sclérosée par 70 ans de stalinisme d’avoir une audience inespérée. Véritable puissance en devenir, l’Inde garde le cap, son attention se centre sur le Pakistan et le contrôle de l’Afghanistan. Les rapports entre Islamabad et New Delhi sont déplorables, et les sources de frictions nombreuses. La région du Cachemire apparaît comme étant le point de cristallisation de toutes les tensions indo-pakistanaise. Une guerre s’avère possible, sans oublier que nous avons affaire à deux puissances nucléaires. Un conflit entre ses deux nations risque d’appeler à une intervention chinoise, qui ne souhaitera pas voir son allié Pakistanais tomber face à l’Inde. Cette dernière ne dispose pas encore d’une industrie et d’une économie suffisamment élaborées pour disputer la première place de la région à Pékin. Elle peut néanmoins se poser en véritable arbitre régional. Son poids ne devrait cesser de croître, d’ici 2050, elle dépassera en population l’Empire du Milieu. La Russie ne doit pas être oubliée, l’immensité de son territoire lui accorde une place en Asie. Elle y suit une politique d’influence douce en vue de confirmer sa position.

La Russie
Pays à cheval sur le continent asiatique et européen, la Russie dispose de par sa dimension d’un poids international incontournable. Cette nation n’a eu de cesse depuis sa création de repousser ses frontières(12). Moscou a une obsession, protéger la périphérie de son Empire. Cette paranoïa se double d’un pouvoir autoritaire séculaire, qui se présente sous des formes différentes au cours des siècles. La dislocation de l’URSS et la grande crise économique d’après guerre froide exacerbent ce sentiment d’isolement. Malgré un poids économique minime – son PIB est inférieur à celui de l’Italie -, Moscou n’hésite pas à se lancer dans des entreprises risquées(13). La Syrie incarne la volonté du Kremlin à l’international. Là où les autres nations tergiversent, Vladimir Poutine intervient et profite de l’immobilisme général pour assurer des gains rapides et durables(14). Il apparaît comme un allié fiable, qui n’hésite pas à se salir les mains. L’appui au gouvernement de Damas place le Kremlin, comme un interlocuteur sur qui il faut compter au Proche-Orient. L’Iran, Israël, la Turquie et les USA n’opèrent pas sans en informer les russes(15). Pourtant la Russie reste structurellement faible, avoir une armée moderne est une chose(16), être en capacité de tenir une guerre économique et démographique en est une autre. La frontière sino-russe inquiète au plus haut point le Kremlin. Les rapports sont cordiaux avec Zhongnanhai, mais ils sont de circonstances. La frontière chinoise subit une immigration, ainsi que des investissements. Cette zone frontalière en Sibérie a été cédé par la Chine en 1858 par le traité d’Aigun(17), et Pékin ne serait pas contre son retour. Le continent russe apparaît comme l’éternel géant aux pieds d’argile, des ressources gargantuesques, mais un pays affaibli par un quasi siècle de communisme. Cette nation cherche à se rassurer et à trouver un interlocuteur fiable. Tout n’est pas perdu pour l’Europe, l’entente reste possible. Il faudra dès lors changer d’attitude, Moscou respecte la puissance et pour l’instant Bruxelles en est exempte.

L’Europe
Véritable berceau des États modernes et du système international(18), les nations européennes cherchent leur place depuis la Seconde Guerre Mondiale. Nous avons déjà évoqué les problèmes inhérents à l’Europe lors de notre article sur l’Union Européenne. La situation a peu évolué depuis, il n’y a pas d’autorité supranationale, ni de véritable feuille de route politique et diplomatique. Bruxelles se laisse porter par les évènements. Les États membres poursuivent leur diplomatie de manière individuelle, mais ont-ils le choix ? Il n’y a pas encore de véritable armée européenne, si ce n’est quelques projets en commun(19). La plus grande construction politique de l’histoire ne va pas se faire aisément, les dirigeants font face à leurs impératifs intérieurs et extérieurs. L’annexion de la Crimée en 2015, l’émergence de l’État Islamique et la vague d’immigration africaine n’apportent pas de réponses définitives. Cet ensemble politique s’avère incapable d’agir de concert. Il se retrouve dans l’impossibilité d’opérer indépendamment et a besoin d’appuis étrangers. L’ancien monde se fait prendre en tenaille à l’extérieur par la Russie à l’est, l’Afrique au sud, sans parler de l’insertion économique de la Chine et du désengagement de Washington. Face à ces défis, l’Europe ne répond pas, que faudra-t-il pour provoquer une véritable avancée dans le projet européen ? Il est pour l’instant faible à l’extérieur et invisible à l’intérieur des États. Il s’agit juste d’un grand marché économique. A l’heure où le continent connait une vague d’immigration sans précédent, qui bouleverse le fonctionnement de ses sociétés, l’avenir de l’Europe semble bien sombre. Au vu de son patrimoine et de sa puissance industrielle, il y a encore des possibilités.
Le monde musulman
L’universalité de cette religion et son application politique aboutit à la formation d’Empires, qui se sont succédés au cours des siècles. Le dernier en date, l’Empire Ottoman s’effondra au début du 20ème siècle. Dès lors, aucun projet politique universaliste ne s’est constitué. La création des États arabes(21) au Proche-Orient, leurs promesses de prospérité et de puissance contrecarra pendant des décennies l’idée d’un monde musulman unifié. Les secousses actuelles résultent de l’échec d’une partie des dirigeants arabes à accomplir la modernisation de leur nation et de la résurgence de l’universalisme musulman(22). Parallèlement à cela, deux nations se disputent la direction des croyants(23) – l’Ouléma – depuis des décennies; l’Iran – Chiite – et l’Arabie Saoudite – Sunnite -. L’affrontement tourne depuis peu à l’avantage de Téhéran(24). La capacité de nuisance des Mollahs dans le détroit d’Ormuz ôte toute envie à quiconque de déclencher une guerre dans cette zone de transit pétrolifère. Un troisième outsider émerge suite à la guerre en Irak de 2003 et profite des guerres civiles consécutives au printemps arabe – 2011 -, il s’agit de l’État Islamique. Cette entité apparaît comme le candidat le plus sérieux. Il se pose en tant qu’autorité supranationale et véritable défenseur des musulmans. Le contexte permettant l’émergence de cette organisation criminelle existe toujours. Ses chefs auront beaux être abattus, tant que l’environnement et l’idéologie extrémiste ne seront pas démontés, il apparaît peu probable que la situation évolue favorablement. Au cours de l’anarchie actuelle, une nation acquiert des gains territoriaux et tire avantage de la situation : la Turquie. Elle conserve son rêve de réémergence d’une partie de son ancien empire et utilise sa position stratégique entre Europe et Orient. La crise syrienne permet à Ankara de faire du chantage à l’UE, notamment sur la question des réfugiés syriens. Elle utilise aussi les islamistes radicaux de tout bord pour affaiblir la Syrie et se débarrasser des Kurdes. Le monde musulman apparaît à la croisée des chemins, la chute d’un État arabe au profit des islamistes risquerait de remettre en question la constitution de ces États à l’occidentale. Il faut aussi tenir compte du schisme entre sunnites et chiites, il marque profondément les politiques extérieures et intérieures de nombre de ces nations. Autre source de division et d’instabilité “Israël”, l’existence de l’État hébreux accentue les rivalités, entre ceux qui affichent leur volonté d’en finir avec Tel-Aviv et ceux qui souhaitent une conciliation. Il apparaît peu probable à court terme que ces deux sujets de division soient résolus. Ces ensembles de facteurs exacerbent le combat de fond entre l’Islam politique – la religion -et les États traditionnels – héritier du nationalisme arabe -.
L’Afrique
Continent torturé, victime de la Realpolitik européenne, l’Afrique apparaît aujourd’hui plus que jamais comme un enjeu entre les puissances. L’augmentation de la demande en matières premières et la faiblesse du continent attisent les convoitises. Les multinationales comme Glencore et les nouvelles puissances veulent leur part du gâteau(25). Nous ne reviendrons pas ici sur ces acteurs, mais sur le fait que l’Afrique reste soumise à des forces extérieures. Les institutions mondiales affichent leur optimisme concernant la croissance et la modernisation en cours; “l’avenir sera Africain”. La réalité est plus contrastée. Il y a bien des nations en plein boom comme la Côte d’Ivoire – 8% de croissance en 2018 -, le Ghana, l’Éthiopie et le Rwanda, mais elles sont seules. Les deux grandes économies du continent que sont le Nigéria et l’Afrique du Sud marquent le pas. L’ensemble des pays du continent font face à des défis colossaux. La croissance démographique phénoménale doublée d’une carence structurelle séculaire amputent une partie de l’excédent économique. Il n’y aurait pas moins de 230 millions d’enfants(26), qui ne sont pas déclarés à la naissance. Cette faillite administrative découlant d’une corruption endémique masque d’autres problèmes inhérents au continent – Voir article sur l’Afrique –. Il est certain que ce riche territoire se dirige vers un tournant historique, soit il se prend en main, soit il s’enfoncera dans la misère. Il sera dès lors pour les voisins immédiats une source d’instabilité et non d’échanges économiques.

Conclusion, la Realpolitik plus que jamais
Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les États-Unis dictent le tempo des relations internationales. Pour les présidents américains successifs depuis Woodrow Wilson, la Realpolitik provoque les guerres par son permanent jeu de puissance – ou équilibre des forces -. Leurs objectifs étaient d’en finir avec cette manière d’appréhender l’ordre mondial. Cette Amérique missionnaire n’a pourtant pu changer la nature des rapports entre nations. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, si cher aux U.S.A. donna la possibilité à un plus grand nombre de pays d’émerger sur l’échiquier mondial. Durant la guerre froide, deux zones d’influences se partageaient le monde et à la chute de l’URSS, le monde devint la sphère d’influence américaine. La Realpolitik ne disparu jamais, elle changea avec son monde en devenant plus dure à appréhender. Les moyens à la dispositions des nations se sont étendus. Une nation de taille modeste peut désormais déstabiliser bien plus puissant qu’elle, et ce grâce aux nouvelles technologies(27). Les pays peuvent aussi faire appel à de puissantes multinationales, qui selon leurs intérêts mondiaux favoriseront tel ou tel État. Le jeu de puissance ne repose plus seulement sur la force brute – économique, militaire et culturelle -, mais aussi sur la qualité des informations que l’on possède et sur le contrôle de ce flux.
Notre monde tend à se diviser en cinq sphères d’influences :
- le bloc Occidental, il comprend les USA, l’Europe et ses divers alliés(28). Il s’est constitué tout au long du 20ème siècle et est le plus avancé.
- Le monde Asiatique, il apparaît sous sa forme primordiale et pour l’instant aucune nation n’en a prit la tête. La Chine ancre ses voisins à son économie pour en prendre le leadership(29). Il reste à voir la réaction de l’Inde, du Japon et des USA sur le long terme.
- L’ensemble Islamique, il est pour l’instant le théâtre d’une lutte idéologique.
- Le groupe des non-alignés rassemble l’Afrique, la Russie et toutes nations ne voulant ou ne pouvant contribuer à une de ces sphères.
- L’association de multinationales aux intérêts convergents formeront le cinquième bloc. Elles suivent leurs intérêts économiques en faisant fi des intérêts nationaux. La création par Facebook de sa monnaie Libra(30) montre que ces entreprises peuvent supplanter les États. Leur domaine d’influence est internet, lieu ou les gouvernements n’ont que peu de prise.

De véritables phases d’instabilités apparaîtront durant la création de ces nouveaux blocs et de leur insertion dans la communauté internationale. Il reste à déterminer leurs durées et leurs ampleurs, cela tient aux dirigeants de ces ensembles. Seront-ils pétris par l’histoire du siècle dernier et de son héritage, faire le monde tous ensemble pour éviter l’innomable ? Ou subirons-nous un nouveau cataclysme ?
Il est possible que ce grand bouleversement ne vienne pas d’ensembles politiques souhaitant émerger. Le changement climatique peut troubler le jeu et forcer la formation d’une coalition mondiale. Tant que les politiques et les peuples n’auront pas de changement violent dans leur quotidien, la réaction se fera attendre. Il reste qu’il faut tenir compte de ce facteur implacable.
(1) Les institutions nées après la Seconde Guerre Mondiale prenaient en compte la nouvelle place des USA. Les accords de Brettons Woods mirent en place le système économique mondial actuel avec la création du FMI – Fond monétaire international- et la BIRD – Banque internationale de reconstruction et développement -. De son côté, l’ONU avait pour objectif d’impliquer l’ensemble des nations dans le jeu de puissance. Lors de la création du conseil de sécurité, cinq membres permanents furent désignés :
- La France et le Royaume-Uni pour leur contribution passée à l’histoire mondiale;
- Les USA et l’URSS pour l’importance de leur poids au sein des affaires internationales;
- La Chine en tant que future hyperpuissance.
Il y a 10 membres non permanents sélectionnés pour une durée de deux ans. Ce système fonctionne depuis plus de 70 ans, et tient à un équilibre subtil. La nomination de nouveaux membres permanents risque de compliquer les discussions.
(2) La Realpolitik est la politique étrangère fondée sur le calcul des forces et l’intérêt national.
(3) La naissance des États européens modernes s’amorce avec l’apparition du concept d’intérêt national sous le Cardinal de Richelieu et la création du concept d’État-nation découlant des accords de Westphalie en 1648.
(4) https://www.herodote.net/8_janvier_1918-evenement-19180108.php
(5) https://www.monde-diplomatique.fr/2001/10/BISHARA/7896
(6) Des exactions furent commises par une partie des soldats américains et leurs supplétifs – Blackwater etc..- :
- https://www.nouvelobs.com/photo/20160825.OBS6879/torture-humiliations-les-photos-qui-ont-revele-l-horreur-d-abou-ghraib.html
- https://www.journaldemontreal.com/2019/09/10/carnage-en-irak-en-2007-peines-reduites-pour-trois-ex-agents-de-blackwater
https://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/quotasf.htm
https://www.diploweb.com/Actualite-et-realite-du-collier-de.html
(9) https://www.bilan.ch/economie/chine-des-statistiques-embellies-masqueraient-elles-des-vulnerabilites
(10) http://www.slate.fr/story/183591/diplomatie-geopolitique-asie-sud-est-choix-chine-etats-unis
(11) Pyongyang utilise la menace nucléaire pour montrer à son peuple que les sacrifices consentis permettent la mise en avant de la nation. La bombe atomique offre la possibilité au régime de marchander des aides économiques et alimentaires contre le ralentissement du programme.
(12) Cette politique agressive assurait la sécurité de la Russie en prévenant toute attaque extérieure et intérieure, en occupant sa population.
(13) Les interventions en Géorgie – 2008 – et en Ukraine – 2014 – auraient pu déclencher des réactions musclées.
(14) L’aide apporté à Damas apparaît comme la plus belle réussite diplomatique et militaire russe depuis la guerre froide. L’intervention armée permet au Kremlin d’assurer la protection de sa base navale de Tartous, et de faire de la Syrie un État satellite.
(15) Moscou équipe l’armée syrienne en armes légères, mais aussi en équipements lourds comme les batteries anti-missiles S-400. Les nations intervenants sur ce territoire sont obligées d’en référer aux autorités russes pour éviter tout malentendu.
(16) https://www.franceinter.fr/monde/l-armee-russe-fait-une-demonstration-de-force-et-en-a-les-moyens
(17) https://les-yeux-du-monde.fr/histoires/11197-les-guerres-de-lopium-ou-le-preambule-3
(18) https://www.historia.fr/la-paix-de-westphalie-le-nouvel-ordre-mondial
(21) Les Accords secrets de Sykes-Picot -1916- ont modelé la forme des futurs États du Proche-Orient.
(22) Il y a toujours eu des appels à l’application d’un islam politique et universel. L’existence de nombreuses associations témoigne de la vivacité de cette idéologie durant les 20ème et 21ème siècle; notamment avec la création des frères musulmans ou du Qutbisme de Sayyid Qutb.
(23) La présence de deux lieux saints musulmans -Médine et la Mecque- permet à l’Arabie Saoudite de se prévaloir de la direction des croyants. L’émergence de la République Islamique d’Iran contrecarre en partie l’aspiration saoudienne. Bien qu’il soit un pays à majorité Chiite, Téhéran se pose en défenseur de la cause musulmane en appelant à la fin d’Israël. L’opposition ne repose pas seulement sur la question religieuse, mais aussi sur le traitement de l’Ouléma.
(24) La révocation de l’accord sur le nucléaire et les sanctions économiques américaines ont acculé l’Iran. Téhéran n’a plus rien à perdre, et joue son va-tout dans le détroit d’Ormuz. L’Arabie-saoudite subit de plein fouet l’offensive de la République des Mollahs. Riyad doit tenir compte de l’avertissement, sinon son économie paiera le prix fort. Pour plus d’informations voir :
https://www.courrierinternational.com/article/chine-turquie-inde-bresil-ils-vont-tous-en-afrique
(27) http://www.slate.fr/story/157186/pays-bas-espionnage
(28) Le Bloc occidental se divisera surement entre deux sous-organisations, une dirigé par les européens et une par les USA. Leur proximité culturelle et historique cimentera les relations entre ces deux sous-ensembles.
(29) Le Bloc chinois sera le théâtre d’une violente lutte d’influence. Il reste à savoir si Pékin arrivera à unir l’ensemble de l’Asie sous sa domination, avant que l’Inde puisse contester son leadership. La seule inconnue est le rôle des USA, vont-ils se désengager ou arbitrer les évènements de la région ?





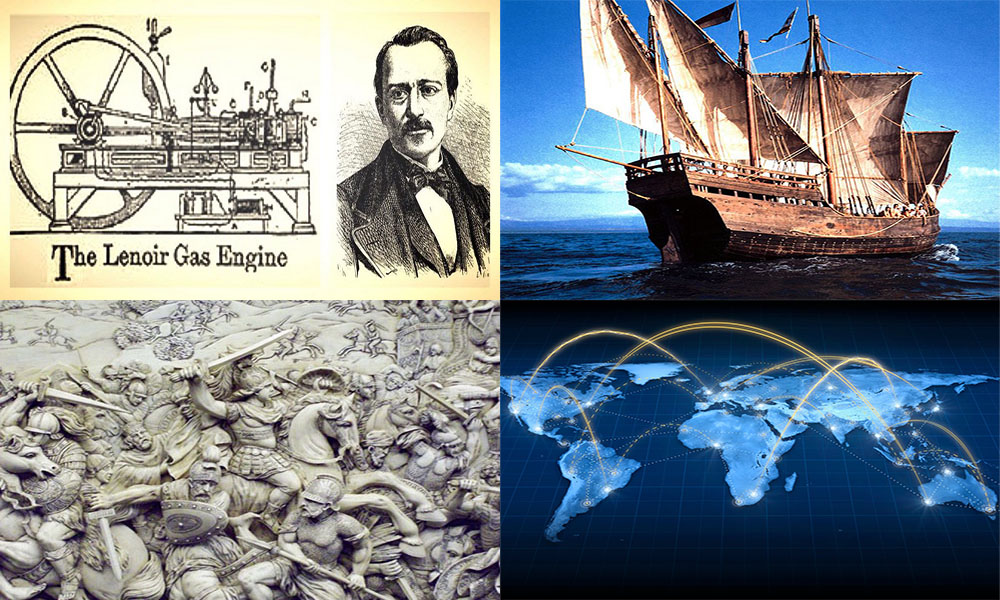

Leave a comment